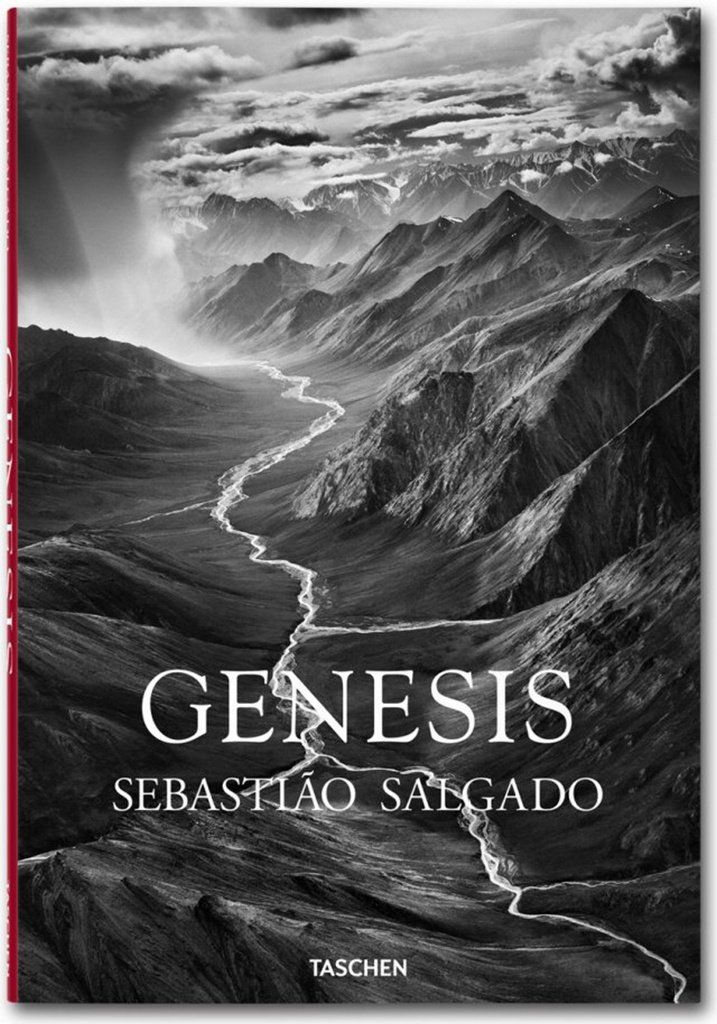« Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream »
Ernest Hemingway, Le Vieil Homme et la mer
J’ai nagé dans les grandes eaux du Gulf Stream en m’efforçant de garder la tête hors de l’eau, mais les courants marins ont eu raison de moi. Le souffle retenu, je me suis laissé emporter. Une attirance sans doute vers les profondeurs obscures, comme celles de l’âme qui recèlent tant de mystères... Ses courants ont des formes légères, des boucles, des volutes - danse fougueuse entre ciel et mer dont je m’abreuve corps et cœur à la source.
Suivant sa trajectoire, on dit du Gulf Stream qu’il quitte le golfe du Mexique par le détroit de Floride, entre Cuba et les Keys, pour remonter vers le nord le long de la côte américaine, piquer vers l’est à la hauteur du cap Hatteras (Caroline du Nord) et traverser l’Atlantique où il s’échoue. D’autres vous diront qu’il prend fin au sud du Grand Banc de Terre-Neuve. C’est peut-être là, l’été de mes 12 ans, que j’ai ressenti sa première chaleur, ses premiers remous, sa force et sa puissance alors que je croyais m’y noyer, emportée à jamais. Au fur et à mesure que ses courants remontent en latitude, les navires marchands qui s’y aventurent triplent leur vitesse de croisière. La chaleur de ses courants préserverait même la Norvège des grands froids. Vous savez quoi? Je m’y laisserais bien tourbillonner pour m’échouer quelque part, dans mes souvenirs d’enfance, tout près des bancs de Terre-Neuve où le sel iodé de la mer saurait me mener.
« La pratique des courants m’aura appris l’abandon, l’obstination et la ruse. Il était temps de rendre hommage à une telle générosité. »
J’ai nagé dans les eaux du Gulf Stream et au final, je me demande pourquoi je me suis efforcée de garder la tête hors de l’eau. Car dans son sillage sous-marin, j’y ai croisé des merveilles d’une beauté inestimable. J’ai suivi la route des tortues Luth de Guyane dans leur traversée de l’Atlantique. J’ai compris la dérive de vaisseaux abandonnés. Une bouteille lancée à la mer en 1837 au Cap Horn aurait été retrouvée vingt ans plus tard en Irlande. Quel message pouvait-elle contenir? Les mots que contiennent une bouteille échouée ne regardent que ceux qui les ont adressés. Ils sont dans le secret des eaux, pleurs de joie ou de tendresse, d’amour ou de détresse...
Que ses grands courants viennent du ciel, du soleil et de son rayonnement, qu’ils proviennent de l’anticyclone des Açores, de l’alizée ou de la lune, des eaux glacées du Labrador ou des banquises du Groenland, je ne rêve plus que de ce Gulf Stream. Nager dans ses eaux et me laisser dériver sur des vagues d’émotions fortes, abandonnée à ses bras marins. Seule au milieu de nulle part. Et rêvant qu'on m'y laisse...
« Il se trouve que, depuis l’enfance, j’aime d’amour les courants marins. J’aime ces fleuves cachés dans l’eau. J’aime me laisser happer et dériver : quelqu’un de fort, soudain, vous prend dans sa paume. Il n’y a qu’à se laisser porter… »
Merci Bison pour cette escale dans les tourbillons du Gulf Stream. En route vers le Mexique... ;-)



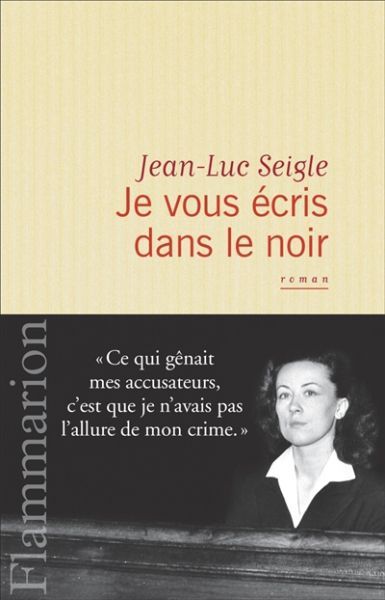

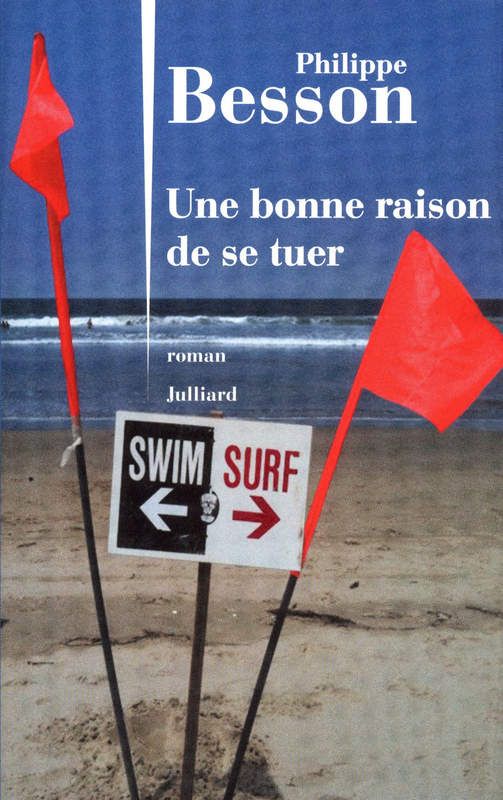




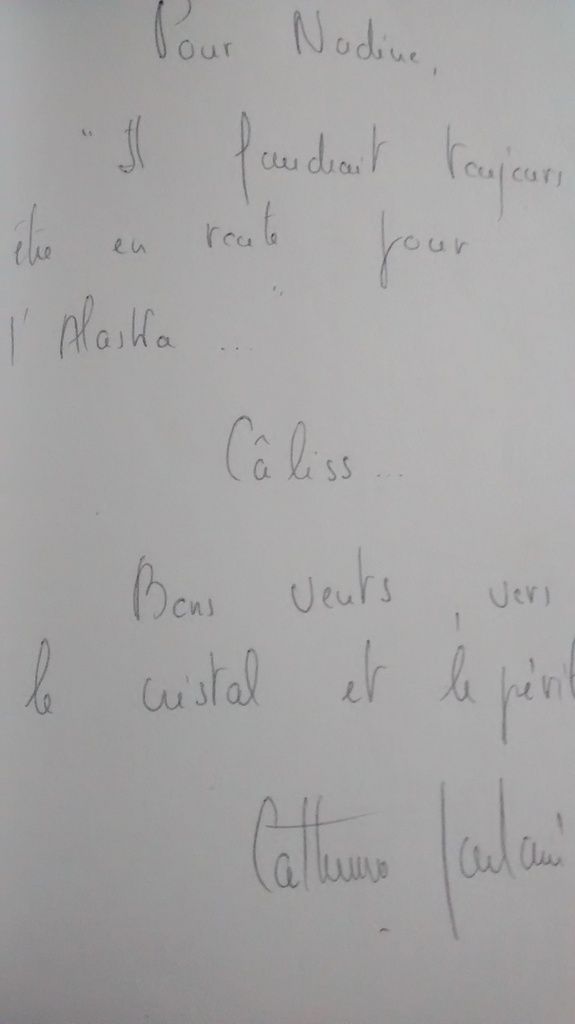
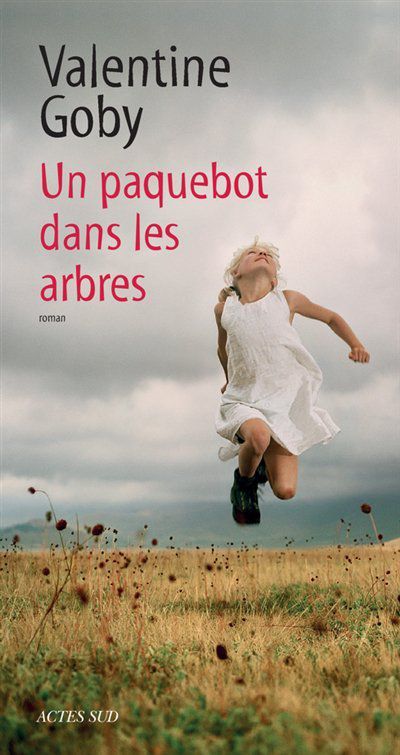
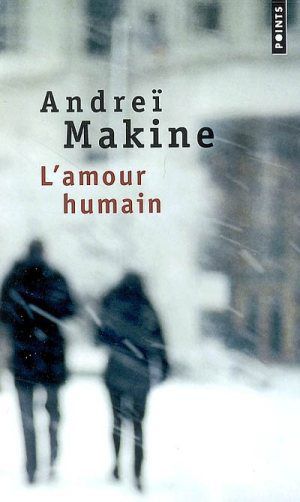



/image%2F1530026%2F20150331%2Fob_dde4e4_coquillage.png)